Lectures scandinaves
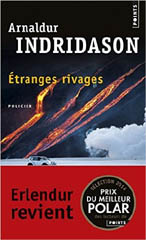 Arnaldur Indridason
Arnaldur Indridason
Étranges rivages
Traduit de l’islandais par Eric Boury
Métailié, 2013
Erlendur est de retour dans les fjords de l’est de l’Islande, son pays natal, et sur cette lande où on l’on disparaît facilement dans la tourmente. Ce fut le cas non seulement de son frère cadet, comme cela nous est rappelé à satiété dans chaque volume, mais aussi, à la même époque, d’un groupe de soldats anglais et d’une femme, une certaine Matthildur qui avait déclaré partir voir sa mère. La région est en plus bouleversée par l’installation d’une gigantesque usine d’aluminium, financée par des capitaux américains (ce qui alimente certaines rancoeurs nationalistes) et par les travaux d’infrastructure qu’elle entraîne. Chez un vieil homme, Erlendur découvre un jouet, une petite voiture appartenant jadis à son frère, qui la portait sur lui le jour de sa disparition et qu’il lui jalousait. A partir de là, il va mener une enquête humaine et non policière – et pour des rasions personnelles et non professionnelles – dans le secteur. Celles-ci vont tourner autour de Matthildur et de son mari, Jakob. Même s’il progresse à l’aide d’une enquête presque policière (recherches d’indices et auditions de témoins), le livre prend alors pendant un certain temps l’aspect d’un roman « normal » tournant autour d’affaires de coeur vieilles d’une soixantaine d’années, avant de virer au policier par raccroc. Non sans agacer le lecteur en piétinant plus que nature et multipliant les répétitions. Celui-ci espère seulement que cela règlera une fois pour toutes cette histoire de disparition du frère cadet d’Erlendur, Ce leitmotiv des romans de l’auteur sur Erlendur finit en effet par devenir lassant et faire figure de facilité. Il est temps d’y mettre le holà, la catharsis est faite pour cela et doit bien être arrivée jusqu’en Islande. En tout cas, la vie (sentimentale) paraît compliquée, au fin fond des fjords de l’est. Le commissaire a beau être « au mieux de sa forme » comme dit la 4e de couverture (par exemple en reconstruisant en esprit des scènes dont seul l’auteur omniscient peut avoir connaissance ?), on a du mal à retrouver le charme particulier des premiers volumes de la série. Les histoires de triangles amoureux (pour ne pas dire de cocu) se ressemblent un peu. Sans compter qu’il est peu vraisemblable, dans une si petite localité, qu’un homme couche avec deux soeurs sans savoir… qu’elles le sont. Et le lien entre les deux versants de l’histoire (le personnel et celui qui concernent des personnes totalement étrangères à Erlendur) paraît bien ténu, même s’il est toujours possible de trouver autre chose que ce que l’on cherche, quand on retourne une pierre. Le plus intéressant et original dans tout cela, reste le rôle d’un certain renard en curieux auxiliaire de police et le plus piquant celui d’Erlendur en violeur de sépulture à répétition. Mais il ne faut pas lire ce livre pour être surpris.

 Henning
Mankell
Henning
Mankell
Sable mouvant
Fragments de ma vie
Traduit du suédois par Anna Gibson
Le Seuil, 2015
Que les lecteurs exclusivement en quête d’intrigue policière passent
leur chemin. Ce livre n’est pas pour eux. Il est en revanche pour tous
ceux qui s’intéressent à ce qui est derrière un livre, à ce qui a fait
qu’un être humain a été amené à écrire et ce qui l’a mis en mesure de
le faire. Il s’ouvre sur la nouvelle que l’auteur apprend un « beau »
jour – comme des centaines de millions d’autres avant et après lui – à
savoir qu’il est atteint d’un cancer. Comme pour beaucoup de
semblables, sans doute, c’est l’occasion d’un retour en arrière à
partir du jour où il a découvert à sa grande stupeur qu’il « était
[lui] et personne d’autre ». Qui ne s’en est pas étonné, en effet, et
ne s’est pas interrogé sur l’enchaînement infini de causes et d’effets
qui a produit ce résultat : lui ! Nombreux sont aussi ceux qui, en
pareille occasion, ont repensé à leur… première cigarette. Et il laisse
son esprit batifoler au long de soixante-huit chapitres d’une moyenne
d’une demi-douzaine de pages. A partir d’un projet d’enfouissement de
déchets radioactifs (pour cent mille ans !) dont il entend parler, il
s’interroge, dans la première partie, sur l’art préhistorique et sa
fonction, les glaciations, la mémoire, l’oubli et sa nécessité, la
fragilité du savoir, la peur. La seconde, elle, aborde de façon un peu
plus structurée, des thèmes tels que la maladie, le mal sous toutes ses
formes, le malheur, la peur… La troisième partie, enfin s’efforce
d’envisager la vie de façon universelle, sub specie aeternitatis en
quelque sorte.1
Ce livre n’est pas sans faire penser aux célèbres Propos de notre
philosophe connu sous le nom d’Alain. Il procède un peu de la même
façon, en partant d’un fait concret, d’un incident de la vie, pour
tisser toute une réflexion mettant à profit l’expérience que procurent
à la fois le nombre des années et, ici, le traumatisme de la maladie.
C’est intelligent et souvent émouvant. Un de ces livres que l’on n’a
pas le sentiment d’avoir lus en vain. Est-il besoin d’en dire plus ?
1 Henning Mankell est
décédé à Göteborg le 5 octobre 2015 à l’âge de 67 ans.
 Eiríkur Örn Norðdahl
Eiríkur Örn NorðdahlIllska (Le Mal)
Traduit de l’islandais par Eric Boury
Métailié, 2015
Voici un livre non seulement totalement hors norme mais dont il est impossible de rendre compte, faute du recul nécessaire. Extérieurement, il se présente comme un « roman » (enfin, presque) bâti sur la vie d’une certaine Agnes Lukauskaite, étudiante islandaise née de parents juifs lituaniens ayant fui le communisme. Elle travaille à un mémoire sur le populisme et rencontre Omar Arnarson, livreur de pizzas quand il n’est pas chômeur, dans une file d’attente de taxis. Mais la matière en est en fait toute l’horreur du XXe siècle (et d’un peu du XXIe) et son poids sur la conscience humaine. Les passages narratifs (d’où est banni tout souci de chronologie, le lecteur doit se débrouiller avec une suite de mises en abîme des plus déconcertantes puisque on est tantôt en Islande tantôt en Lituanie, parfois ailleurs encore, à une date en général impossible à préciser – le résultat étant une sorte de vaste no man’s land spatio-temporel) sont en effet séparés les uns des autres par des considérations sur le fascisme, le racisme (y compris celui des Islandais vis-à-vis des…Lituaniens !), l’Holocauste, « l’altérisation » (thème sur lequel l’auteur revient sans cesse) etc. L’existence d’Agnes est un puzzle de quelques milliers de pièces d’autant plus difficile à reconstituer que l’histoire d’amour sur laquelle elle repose est narrée pour l’essentiel (à la première personne) par Omar, qui souffre tellement de son infidélité avec le néonazi Arnor Thordarsson qu’il met le feu à leur maison (passages d’ailleurs un peu rébarbatifs, il faut le dire). Sans compter le dialogue que l’auteur entretient avec Snorri, le fils qu’Agnes a d’Omar – à moins que ce ne soit d’Arnor, elle ne le sait pas trop elle-même –, sorte de « chronique de la croissance d’un être humain » à la seconde personne qui constitue une partie presque autonome du récit. Le tout sur fond de traumatismes nationaux (les crises financières du début des années 80 et 2008) et de scènes de massacres de masse (en Lituanie) vécues rétroactivement et au cours desquelles l’un des grands-pères d’Agnes tue l’autre, qui complètent un tableau à donner le vertige.
Il est impossible d’embrasser intellectuellement un tel
livre à la première lecture (reste à savoir si ce l’est à la seconde,
troisième, etc.). En cela, il est à l’image d’un monde «
postpostmoderne », impossible à saisir par la pensée, avec son infinité
de possibilités enthousiasmantes dans le positif et horrifiantes dans
le négatif. Quoi qu’il en soit, ces 600 pages en forme de « sorte de
roman » mâtiné de traité de philosophie, morale et politique,
constituent un défi dont il faudra longtemps pour relever l’ampleur. Un
nom à suivre dans les années à venir, même si l’on peut se demander de
quoi ce jeune auteur (de 34 ans à la publication de son livre) sera
capable après un tel exploit. Un coup de chapeau, aussi, à l’éditeur
français, qui a assumé un tel risque, et au traducteur, qui s’est
brillamment acquitté d’une tache redoutable.
Citation : « Si
la Seconde Guerre mondiale nous a enseigné quelque chose, elle nous a
appris l’oubli. À oublier de ne pas oublier. À ne pas oublier d’oublier
de ne pas oublier. À ne pas laisser retomber la pâte. »

 Leena
Lehtolainen
Leena
LehtolainenLa Spirale de la mort
Traduit du finnois par Anne Colin du Terrail
Gaïa, 2015
Le cadavre d’une jeune fille de 16 ans, Noora Nieminen, étoile montante du patinage artistique finlandais, est découvert par une mère de famille, Kati Järvenperä, au retour de ses emplettes, dans le coffre de sa voiture garée dans le parking d’une grande surface. Elle avait certes omis de la verrouiller, estimant qu’elle était trop vieille et ne contenait rien de nature à attirer les voleurs. C’est tout de même un choc pour elle que ce colis inattendu et désagréable. C’est bien entendu Maria Kallio, l’inspectrice chère à l’auteur, qui est chargée de l’enquête et la raconte à la première personne. L’arme du crime est vite retrouvée : il s’agit des patins de la victime. Il convient donc d’interroger en priorité son entourage, jeunes collègues et entraineurs, parmi lesquels les motifs de friction ne manquent pas. Il y a même un suspect tout désigné en la personne de Vesku Teräsvuori; roi du karaoké à la réputation sulfureuse, pour qui la mère de Noora a quitté un temps son mari. Mais il dispose d’un solide alibi. Et aussi Ulrika Weissenberg, l’entraîneur qui s’est disputée avec Noora peu avant sa mort et a laissé un bout d’ongle dans ses cheveux. Bref, un petit monde du sport-spectacle traversé par les jalousies et les rivalités. Et, comme souvent dans les polars, un meurtre en entraîne un autre. L’enquête se poursuit avec les méandres habituels, gages d’une certaine véracité, la narration à la première personne ne faisant bien sûr que renforcer cette impression. Étant donné le milieu très limité dans lequel elle a tourné, le dénouement ne pouvait guère offrir une surprise de taille. On regrettera plutôt qu’il sacrifie à la mode d’un affrontement final qui détonne un peu par rapport à la sobriété du reste du livre.
La touche d’originalité est apportée par le sexe de l’enquêtrice, qui est enceinte. Sa grossesse tient une large place dans le livre, l’auteur n’épargnant aucun détail à ce sujet et allant jusqu’à une scène finale d’accouchement qui a tout du manuel d’obstétrique – sans doute pour l’édification de lecteurs masculins auxquels est offert un bon rapport qualité-prix, sous ce rapport. Ce dont on peut aussi féliciter Leena Lehtolainen, c’est de ne pas tenter de rivaliser avec ces innombrables « reines de polar nordique » (combien à ce jour ?) qui s’estimeraient déshonorées de ne pas larder leur produit de rebondissements et coups de théâtre au rythme d’un par chapitre, de complots informatico-politiques planétaires, de mystérieux coupables qu’on suit pas à pas grâce à un « il » ou « elle » anonyme (bref, toutes les recettes « incontournables » du polar vendu à tant de millions d’exemplaires et traduit dans toutes les langues du monde – sauf l’inuit, quand même). Nous avons ici une enquête assez simple et narrée simplement dans ses innombrables hasards et hésitations. Qu’on nous permette de trouver cela à la fois plus convaincant et moins… fatigant.

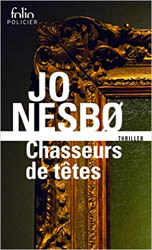 Jo Nesbø
Jo Nesbø
Chasseurs de têtes
traduit du norvégien par Alexis Fouillet
Folio policier, 20151
Le livre est narré à la première personne par un chasseur de tête nommé Roger Brown et ne fait pas intervenir, cette fois, Harry Hole, le personnage favori de l’auteur. Il s’ouvre sur un bref prologue décrivant (de l’intérieur) un accident de voiture et se divise ensuite en cinq parties. Cela commence par un entretien de recrutement mené selon des règles de l’art que nous explique très consciencieusement Brown lui-même, en soulignant à plaisir tout ce que son univers a de snob et de frelaté. Il nous explique aussi que Diana, sa femme, ayant de gros besoins financiers, ces entretiens visent en fait à lui procurer les informations nécessaires à de juteux cambriolages qu’il met au point avec la complicité d’employé d’une entreprise de sécurité. Il vise particulièrement des tableaux de maîtres qu’il remplace temporairement par des photocopies perfectionnées, le temps d’écouler les originaux auprès d’un receleur. Tout marche bien jusqu’à ce qu’il tombe sur un certain Clas Greve, chez qui il découvre que… sa femme le trompe avec sa victime. Mais ce n’est que le début d’une longue série d’événements rocambolesques. Il se retrouve alors avec le cadavre de son complice sur les bras. Puis il prend un bain d’excréments, au sens très littéral du terme (ce qui nous vaut un morceau de bravoure de plusieurs pages), prend la fuite à bord d’un tracteur et se voit accuser (sous un nom qui n’est pas le sien) du meurtre de quelqu’un qu’il connait à peine. Puis le jeu de cache-cache avec la mort se perfectionne encore : Brown maquille un cadavre de policier pour faire croire que c’est lui qui est mort, rentre chez lui clandestinement pour tuer la femme infidèle et réussit encore à faire croire que Greve a été tué par son ancien complice à lui (pourtant déjà mort !). Et au passage, il bat le record du nombre de victimes en un temps très réduit. Finalement, l’auteur se paie encore le luxe d’une élucidation très solennelle – et totalement fausse, bien entendu – de l’affaire au cours d’un journal télévisé. Puis une dernière pirouette pour la route. Le vrai récit de faux meurtres est-il vrai ou faux? Grave question ! Sans compter ces originaux de tableaux qui sont des faux. C’est de la haute voltige d’imagination, qui n’exclut pourtant pas des aspects plus sérieux, au premier rang desquels le refus de la paternité.
Très honnêtement, le livre vaut moins par une intrigue policière plus tarabiscotée que nature que par l’ambiance farfelue à la San Antonio. D’autant que le style est à l’avenant : parodiquement goguenard et percutant, et que le rythme est endiablé. Nesbø aime jouer avec son lecteur, qu’il sait qu’il mène par le bout du nez, et il ne s’en prive pas, une fois de plus. On ne s’ennuie pas une minute, à la lecture de ce livre pas très long au regard de certains pavés, et contrairement à ce qui se passe avec beaucoup d’autres auteurs de policiers actuels, qui sont d’un sérieux parfois pénible. Sans compter qu’on apprend quelque chose d’utile : une couche d’excréments rend les GPS inopérants. À une époque où Big Brother nous traque jusque dans les toilettes, justement, ce n’est pas sans intérêt.
1 Initialement paru en 2009 chez Gallimard à la Série Noire

 Arni Thorarinsson
Arni Thorarinsson
Le Crime – une
histoire d’amour
traduit de l'islandais par Eric Boury
« Bibliothèque nordique »
Métailié Noir, 2016
Malgré son format réduit (140 pages pas très denses), ce livre est construit avec subtilité. Il s’ouvre sur un prologue au cours duquel un homme, psychologue de métier et écrivain à ses heures, rêve de cadavres et regrette sa fille, Frida, qu’il ne voit plus depuis une dizaine d’années. Suivent vingt-cinq chapitres (parfois entrecoupés de bribes de chanson) alternant les points de vue, dont certains, intitulés Nous, sont en forme de lettre mâtinée de journal intime tenu par un personnage féminin, qui nous conte en fait le passé de cette famille et par lequel nous apprenons le secret qui pèse sur elle (et qu’il faut naturellement se garder de révéler ici). Les autres suivent les faits et gestes de la fille, du père et de la mère. Le récit s’ouvre le jour des dix-huit ans de Frida, qui vit maintenant avec Brynhildur, une amie qu’elle aide à tenir une boutique de mode et qui décide de faire donner une bonne leçon au père de sa copine par une bande de jeunes anarchistes de sa connaissance (qui vont se tromper bêtement de cible !). Le père reçoit un coup de téléphone anonyme lui intimant l’ordre de tenir la promesse qu’il a faite à Frida (à savoir de lui dire, lorsqu’elle serait majeure, pourquoi sa femme et lui se sont séparés). Depuis son divorce, la mère de Frida mène une existence chaotique de clocharde, pocharde, droguée et sans doute prostituée occasionnelle. Elle est plus ou moins hébergée par un vieil original, Hlynur, mais Frida l’a filmée à l’état d’épave, dans la rue, et a mis la vidéo sur Internet. Et elle a des dettes envers une certaine Jane, qui la tyrannise. Mais c’est aussi une femme instruite et très littéraire, qui est en fait l’auteur du journal intime. Les différents itinéraires se croisent au cours d’une seule et même journée très dramatique, jusqu’à un dénouement à la fois dur et apaisé.
Malgré son titre, ce roman n’est pas vraiment un policier (il n’y a ni cadavre ni enquête, au coeur de cette histoire, le crime en question est d’ordre moral et assumé, il n’a donc pas à être découvert ni sanctionné). C’est plutôt au sous-titre qu’il faut ajouter foi et en fonction de quoi il faut le juger. Sur ce plan, il donne toute satisfaction, ce qui est fort méritoire, sur un sujet aussi éculé qu’un couple et une famille à la dérive. Il est superbement composé et très émouvant. Comme quoi il n’est pas nécessaire d’aligner des centaines de pages pour narrer une histoire convaincante. Ni des tonnes d’explications, simplement des faits bien choisis et des dialogues révélateurs. On peut même aborder ainsi de graves problèmes de philosophie morale, qui ne sont plus abstraits ni schématiques, dès lors qu’ils sont ainsi incarnés dans des destins humains, fussent-ils fictifs. Une belle leçon de littérature, tout simplement, qui fait que nous ne nous apercevons qu’après coup de l’absence d’Einar. Mais ce n’est sûrement que partie remise.
Philippe Bouquet